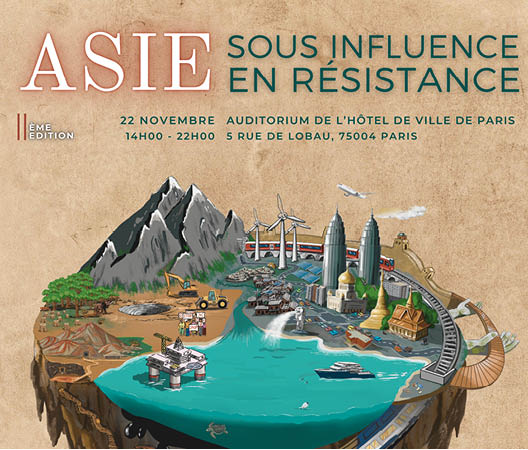Contexte
En France, les libertés fondamentales et le droit d’asile sont des éléments cruciaux qui assurent la protection des droits humains, permettant à chacun de vivre en sécurité et de s’exprimer librement. Cependant, ces principes sont menacés par des contextes sociaux et sécuritaires, comme en témoigne la fragilisation du droit d’asile et de la liberté de manifester à travers diverses réformes législatives et des mouvements sociaux violents.
Sûreté et Libertés : la France n’est pas exemplaire
Longtemps considérée comme un modèle en matière de gestion des foules, la France est désormais critiquée par les principales institutions européennes et internationales pour avoir recours à une force jugée excessive, voire mortelle. En effet, le maintien de l’ordre français actuel se caractérise par l’usage d’armes de force intermédiaire mutilantes comme le lanceur de balles de défense (LBD) ou les grenades à main de désencerclement, l’usage disproportionné de gaz lacrymogènes ou encore l’emploi d’agents non formés au maintien de l’ordre. Pourtant interpellée par les Nations unies et le Conseil de l’Europe, la France n’a opéré aucun changement législatif ou réglementaire.
La matière carcérale n’est pas en reste. La France est le troisième pays européen avec la surpopulation carcérale la plus importante, derrière Chypre et la Roumanie. Le non-respect de l’encellulement individuel, ainsi que la vétusté et le manque d’entretien de certains établissements, font que les conditions sont souvent indignes en détention. Pour ces raisons, la France a déjà été à plusieurs reprises condamnée pour “traitements inhumains et dégradants” par la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) et n’a pourtant pas encore remédié à sa problématique chronique de surpopulation carcérale.
L’ACAT-France se mobilise afin que le respect des droits de l’Homme et de l’État de droit reste une priorité et que la France respecte ses engagements internationaux en la matière.
Droit d’asile : les réformes inquiétantes de 2024
En France, une nouvelle réforme sur l’asile et l’immigration a été adoptée le 26 janvier 2024. Les nouvelles dispositions qu’elle contient établissent un régime de l’asile placé sous le signe de l’accélération des procédures et de la facilitation des expulsions. Dans la mise en œuvre, le risque est celui de compromettre la qualité des décisions et de potentiellement priver les personnes vulnérables d’une protection à laquelle elles ont droit. D’autant plus que la France devra proposer d’ici décembre 2024 son plan d’action pour l’application de la réforme européenne, opérée à travers le Pacte sur la migration et l’asile du 10 avril 2024. Ce cadre juridique européen marque une véritable régression des droits fondamentaux, avec une logique de filtrage par nationalité et d’enfermement.
L’ACAT-France reste mobilisée sur le déploiement des actions permettant la préservation du droit d’asile, aux côtés de ses partenaires de la Coordination française pour le droit d’asile (CFDA) et de l’association nationale d’assistance aux frontières pour les étrangers (ANAFE), avec qui elle agit au quotidien.
la France en chiffres.
Sources des chiffres clés :
Rapport IGPN
Frontex