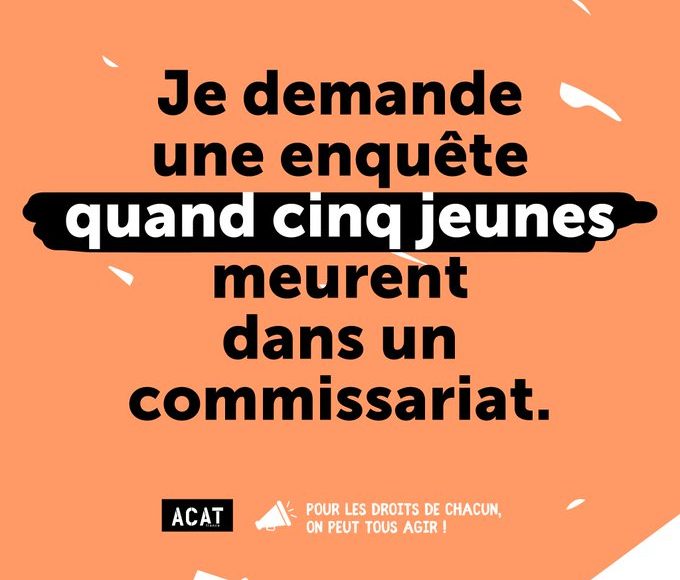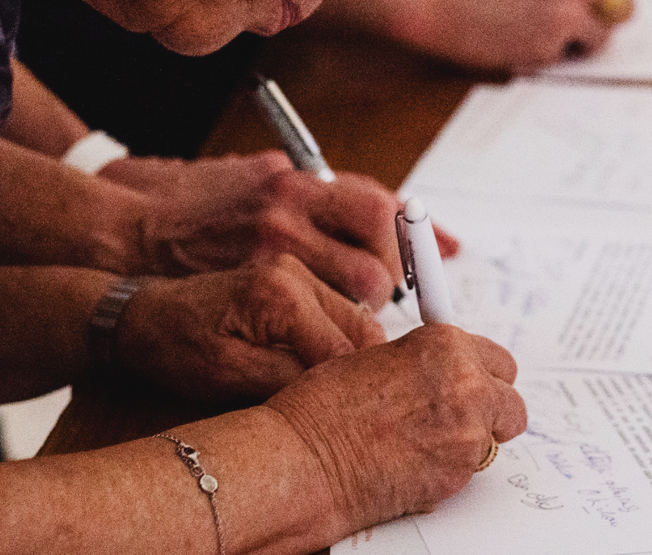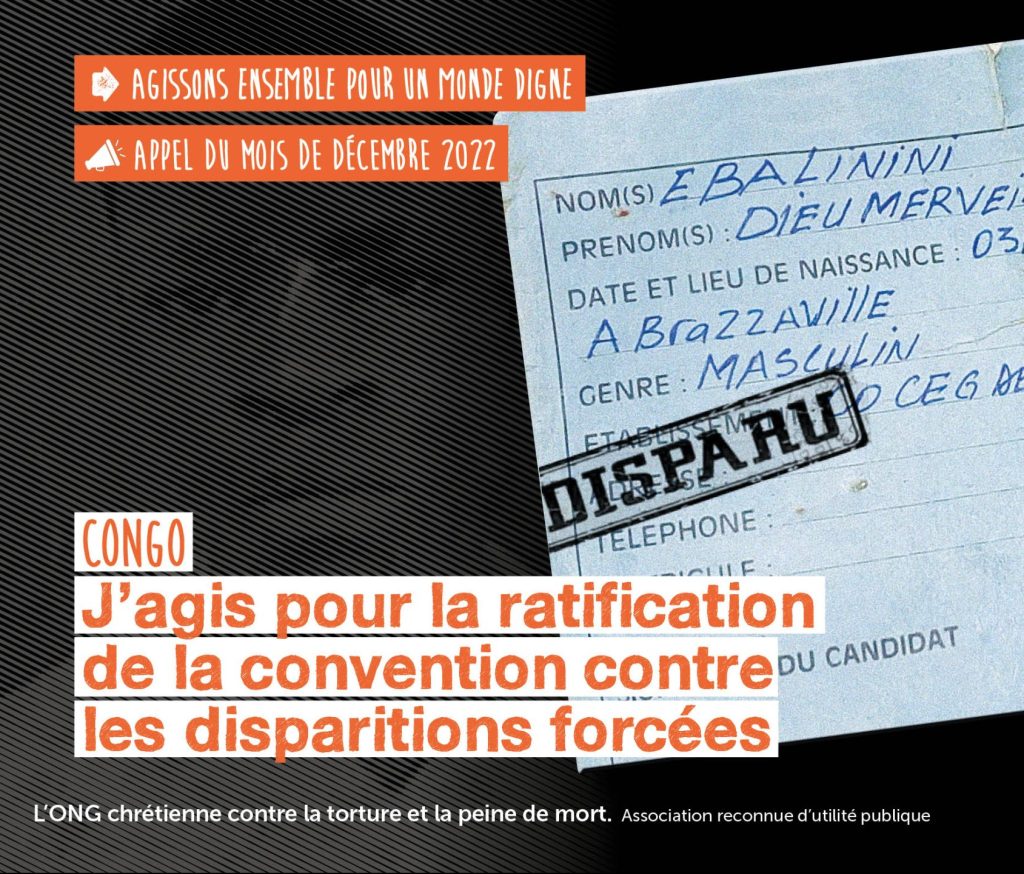Contexte
La situation politique en République du Congo, également appelée Congo-Brazzaville, est marquée par un régime autoritaire au pouvoir. Le président Denis Sassou Nguesso est au pouvoir depuis 1979, avec une interruption de cinq ans entre 1992 et 1997. Depuis sa reprise du pouvoir par les armes en 1997, il a été réélu à plusieurs reprises à l’issues d’élections controversées marquées par des accusations de fraude et de répression et d’un changement constitutionnel en 2015 lui permettant de se maintenir au pouvoir. Son régime est régulièrement critiqué pour son contrôle étroit des institutions et l’absence d’une réelle alternance politique.
Alors que le pays possède d’importantes ressources naturelles, notamment du pétrole, une grande partie de la population vit dans la pauvreté, illustrant une mauvaise gestion des richesses nationales et une corruption endémique de la classe dirigeante. Le Parti congolais du travail (PCT), au pouvoir, exerce une influence quasi totale sur les organes législatifs et exécutifs, tandis que les partis d’opposition peinent à mobiliser dans un environnement marqué par la peur et le clientélisme. Le régime contrôle également une partie importante des médias, restreignant la liberté d’expression et limitant l’accès à l’information critique.
Situation générale des droits humains
La situation des droits humains demeure préoccupante, marquée par des violations graves et systématiques. Le régime au pouvoir est régulièrement accusé de réprimer les opposants politiques et les voix dissidentes.
Dans la région du Pool, bien qu’un accord de cessez-le-feu ait été signé en décembre 2017 ayant ramené la paix dans cette région, les populations locales continuent de subir des restrictions de mouvement, des arrestations arbitraires et une militarisation excessive.
Par ailleurs, la lutte contre le banditisme urbain, notamment contre les « bébés noirs » (gangs de jeunes), donne lieu depuis 2017 à de graves abus des forces de l’ordre. Ces opérations, officiellement menées pour garantir la sécurité, se traduisent par des exécutions extrajudiciaires, des disparitions forcées, des actes de torture et des détentions illégales. Ces exactions, dénoncées par les associations, reflètent une justice défaillante et une culture d’impunité.
Enfin, la société civile et les défenseurs des droits humains travaillent sous pression constante, confrontés à des intimidations et à un espace de plus en plus restreint. Ces dynamiques témoignent d’un régime qui privilégie le contrôle autoritaire au détriment des libertés fondamentales et de la dignité humaine.
La liberté d’expression et de la presse est restreinte. La République du Congo figure à la 69ème place du classement mondial de la liberté de la presse de Reporters Sans Frontières (RSF) en 2024. L’autocensure demeure la règle dans le secteur médiatique.
Pratique de la torture
L’usage de la torture au Congo-Brazzaville est une pratique courante, particulièrement dans le contexte de la répression politique et des détentions dans les commissariats de police. Les forces de l’ordre utilisent régulièrement la torture pour extorquer des aveux, intimider des opposants politiques ou exercer un contrôle par la terreur, notamment dans le cadre de la lutte contre les « bébés noirs ». Des cas emblématiques, comme les décès de 13 jeunes hommes sous la torture dans un commissariat de Brazzaville en 2018 ou des vidéos montrant des actes de brutalité extrême commis par des policiers sur des détenus, illustrent la banalisation de ces abus.
Ces violences, souvent filmées et diffusées sur les réseaux sociaux, provoquent parfois un tollé, forçant les autorités à agir ponctuellement. Cependant, ces réactions restent limitées, et la plupart des auteurs ne sont pas inquiétés par la justice. Ce climat d’impunité favorise la persistance de la torture, avec une quasi-absence de mécanismes de protection des droits humains et une tolérance implicite des autorités congolaises.
État de la peine de mort
La nouvelle constitution de la République du Congo adoptée par référendum le 25 octobre 2015 abolit la peine de mort. Elle précise explicitement dans son article 8 que « la personne humaine est sacrée et a droit à la vie. L’État a obligation de la respecter et de la protéger. (…) La peine de mort est abolie ». L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté une loi le 13 octobre 2020 visant à abolir la peine de mort. Toutefois, rien n’a bougé depuis la publication de ladite loi au Journal officiel de la République du Congo du 22 octobre 2020. Dans le Code pénal congolais, la peine de mort est encore mentionnée. La dernière exécution remonte à octobre 1982.
Le Congo en chiffres.
Sources des chiffres clés :
Reporters Sans Frontières (RSF)