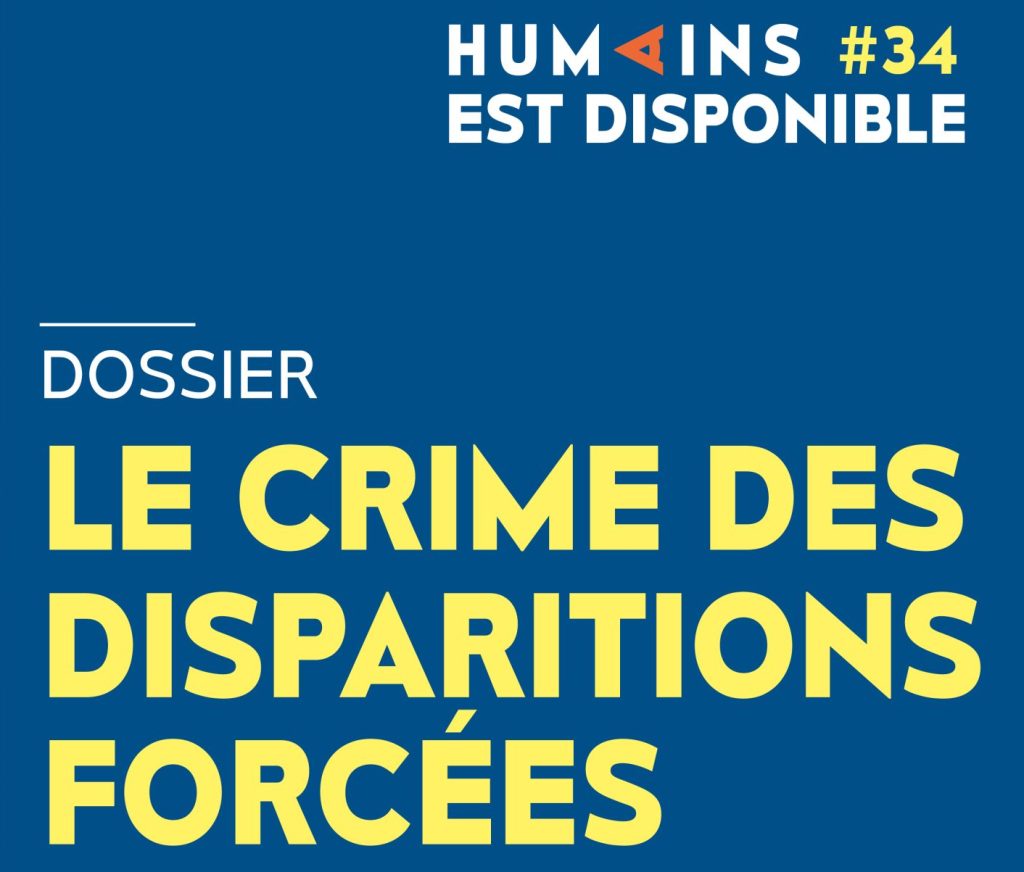Contexte
L’élection en mai 2020 du président Évariste Ndayishimiye avait suscité l’espoir de mettre un terme à la crise systémique des droits humains au Burundi. Mais malheureusement, il n’en est rien car le parti au pouvoir, le CNDD-FDD, a en réalité conservé son monopole sur le pays après les élections de 2020, et se maintient au pouvoir par l’instauration d’un climat de peur et le contrôle de la population.
Situation des droits humains au Burundi
L’accession au pouvoir d’Évariste Ndayishimiye à la tête de l’État burundais aurait pu être annonciatrice de réels changements en matière d’amélioration effective des droits humains. En dépit de quelques gestes symboliques, comme la libération de plusieurs défenseurs des droits de l’Homme (Nestor Nibitanga, Germain Rukuki, Tony Germain Nkina) et de journalistes injustement emprisonnés, la situation des droits humains au Burundi reste préoccupante.
L’exercice du journalisme est difficile, et la société civile et les médias indépendants ne sont pas toujours libres d’exercer librement leur métier. Pour preuve, une journaliste, Sandra Muhoza, est actuellement détenue arbitrairement et douze défenseurs des droits de l’Homme vivant à l’étranger demeurent sous le coup de condamnations iniques, et leurs structures sont interdites au Burundi. Parmi eux, Maître Armel Niyongere, Président de l’ACAT-Burundi, lauréat du Prix Engel-Dutertre 2020 de la Fondation ACAT pour la dignité humaine.
Les exécutions extrajudiciaires et les disparitions forcées d’opposants se poursuivent également, et les milices pro-gouvernementales – plus couramment appelées Imbonerakure – ne sont toujours pas dissoutes et continuent de terroriser la population, partout dans le pays.
Pratique de la torture
Depuis la violente crise politique de 2015, la pratique de la torture s’est généralisée, en particulier au sein du Service national de renseignement (SNR). L’impunité reste la norme pour les auteurs et responsables de violations graves des droits humains, notamment en ce qui concerne les nombreuses disparitions forcées survenues après 2015, y compris celle du journaliste Jean d’Iwacu. L’ACAT-France continue de se mobiliser pour obtenir justice pour ce cas et d’autres similaires.
État de la peine de mort au Burundi
En 2009, l’adoption du nouveau Code pénal au Burundi a suscité à la fois de la satisfaction et de la déception. D’un côté, cette nouvelle législation a aboli la peine de mort et a prévu des sanctions pour les actes de torture, le génocide, les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité.
le Burundi en chiffres.
Sources :
ACAT-France
Amnesty International