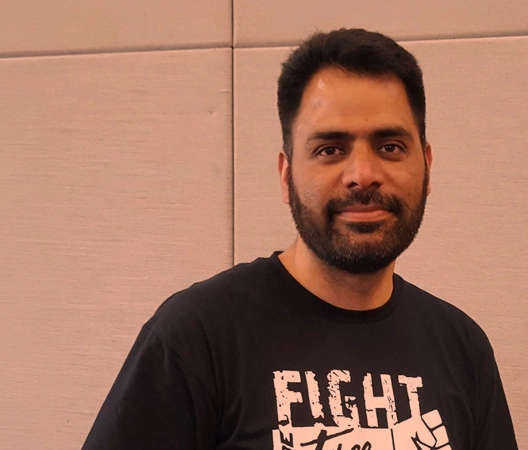Le 16 décembre 2024, le Tribunal de Grande Instance de Mukaza, à Bujumbura, a condamné la journaliste burundaise Sandra Muhoza à dix-huit mois de prison ferme, pour « atteinte à l’intégrité du territoire national » ainsi qu’à trois mois de prison ferme pour « aversion raciale ». Ces condamnations, dénoncées par la société civile et les organisations de journalistes, reposent sur des accusations fallacieuses et politiquement motivées.
Qu’est-il reproché à Sandra Muhoza ?
Quelques jours après avoir fait des commentaires dans un groupe privé WhatsApp intitulé « Burundi Médias », à propos d’un article faisant état d’une distribution présumée de machettes à travers le Burundi par le parti au pouvoir, le Conseil national pour la défense de la démocratie – Forces de défense de la démocratie (CNDD-FDD), à des jeunes Imbonerakure – jeunes militants de ce parti, Sandra Muhoza, correspondante à Ngozi pour le journal en ligne La Nova Burundi, est arrêtée le 12 avril 2024 par le commissaire du Service national de renseignements (SNR). Elle est transférée le soir même à Bujumbura. Après vingt-quatre heures sans nouvelles, sa famille reçoit, le 13 avril 2024, un SMS depuis le téléphone de la journaliste, indiquant qu’elle est détenue au SNR de Bujumbura. Le 18 avril, Sandra Muhoza est placée sous mandat de dépôt à la prison centrale de Mpimba, située à Bujumbura, pour « atteinte à la sécurité de l’État et aversion ethnique ».
Une justice partiale et politisée
Après environ sept mois de détention provisoire, le procès de Sandra Muhoza se tient le 12 novembre 2024 au Tribunal de Grande Instance de Mukaza à Bujumbura. Lors du procès, Sandra Muhoza apporte des explications sur les propos qu’elle a tenus au sein du groupe WhatsApp réunissant des journalistes burundais. « Mes parents ont été emportés par la tragédie qui a suivi l’assassinat du président Melchior Ndadaye en 1993. J’ai eu peur que cela se reproduise » indique-t-elle pour justifier le partage, en privé, d’informations relatives à une distribution présumée de machettes par le CNDD-FDD, parti au pouvoir, à des Imbonerakure, jeunes militants du parti. Il s’agit de surcroît d’une information qui avait déjà circulé publiquement dans plusieurs médias avant d’être retirée. Malgré ces explications et un dossier à charge basé uniquement sur ce fait, le ministère public requiert douze ans d’emprisonnement ferme, dont dix ans pour « atteinte à l’intégrité du territoire national » et deux ans pour « aversion raciale », ainsi qu’une amende d’un million de francs burundais (environ 320 euros). Le 16 décembre, le Tribunal de Grande Instance de Mukaza rend son verdict. Sandra Muhoza est condamnée à dix-huit mois de prison ferme pour « atteinte à l’intégrité du territoire national » et à trois mois de prison ferme pour « aversion raciale », deux peines cumulatives.
L’affaire Sandra Muhoza révèle, comme plusieurs autres affaires passées relatives à des condamnations de voix critiques et indépendantes au sein de médias ou d’associations de défense des droits humains, une justice instrumentalisée par le pouvoir exécutif. L’emprisonnement et la condamnation abusive de Sandra Muhoza sont perçus comme une attaque directe contre la liberté de la presse, visant à intimider et museler la presse et plus largement la société civile à l’approche des élections législatives et communales de 2025.
Mobilisons-nous pour dénoncer cette injustice et exiger la libération de Sandra Muhoza !
Contexte
L’incarcération de Sandra Muhoza est une atteinte directe à la liberté d’expression et un signal alarmant pour tous les journalistes au Burundi. Cette affaire illustre à quel point la liberté de la presse reste gravement menacée dans le pays et que la justice, censée être indépendante, est instrumentalisée par le pouvoir exécutif pour museler les voix critiques.
Un climat de répression continue à l’endroit de la liberté de la presse
Depuis la tentative de coup d’État de mai 2015, les autorités burundaises ont instauré un climat de répression à l’encontre de la société civile et de ses voix dissidentes. Une centaine de journalistes ont été contraints à l’exil, et les médias indépendants ont subi fermetures et interdictions. Bien que l’élection d’Evariste Ndayishimiye en 2020 ait suscité quelques espoirs, notamment avec la réouverture de certains médias comme Iwacu, ces avancées restent fragiles. Le Conseil National de la Communication (CNC), censé garantir la liberté de la presse, fonctionne souvent comme un organe de contrôle visant à censurer les débats critiques. Le Burundi occupe en 2024 la 108ème place sur 180 pays dans le classement mondial de la liberté de la presse de Reporters sans frontières (RSF). Ce classement témoigne de l’environnement hostile dans lequel travaillent les journalistes burundais, souvent poussés à l’autocensure par crainte de représailles. L’une des affaires récentes de durcissement à l’égard des journalistes burundais est celle de Floriane Irangabiye, condamnée à dix ans de prison en janvier 2023 avant d’être graciée après plus de sept cent jours de détention arbitraire, suite à une forte mobilisation internationale en sa faveur.
Actuellement, deux lois liberticides de 2018 régissent le travail des associations et des médias et permettent aux autorités burundaises de contrôler les activités de la société civile.
Répression continue des défenseurs des droits humains
Les autorités burundaises maintiennent une pression constante sur les défenseurs des droits humains. Douze défenseurs des droits humains et journalistes burundais en exil – dont Armel Niyongere, président de l’ACAT-Burundi – font encore aujourd’hui l’objet de condamnations à des peines de prison à perpétuité. Ces personnes avaient dû fuir le Burundi en 2015 après avoir fait l’objet de menaces de la part du régime du président feu Pierre Nkurunziza, qui souhaitait alors briguer un troisième mandat en dépit de la limitation constitutionnelle fixée à deux mandats. Ces personnes dirigeaient des associations et des médias qui effectuaient un travail d’enquête, de documentation et de médiatisation des violences commises par les forces de défense et de sécurité contre les dissidents. Ces associations et médias se sont vus interdire d’exercer leurs activités au Burundi. L’ACAT-Burundi a été radiée par le ministère de l’Intérieur en octobre 2016 après que ses comptes bancaires ont été fermés en novembre 2015. En janvier 2017, Armel Niyongere a été radié de l’ordre des avocats comme trois autres avocats-défenseurs des droits humains. Malgré ces obstacles, l’ACAT-Burundi poursuit son engagement depuis l’exil, continuant à documenter les violations des droits humains et à plaider pour la justice. En octobre 2024, le Conseil des droits de l’homme des Nations unies a souligné la persistance de la répression des opposants politiques, des professionnels des médias et des défenseurs des droits humains au Burundi, ainsi que l’impunité généralisée des auteurs de violations.