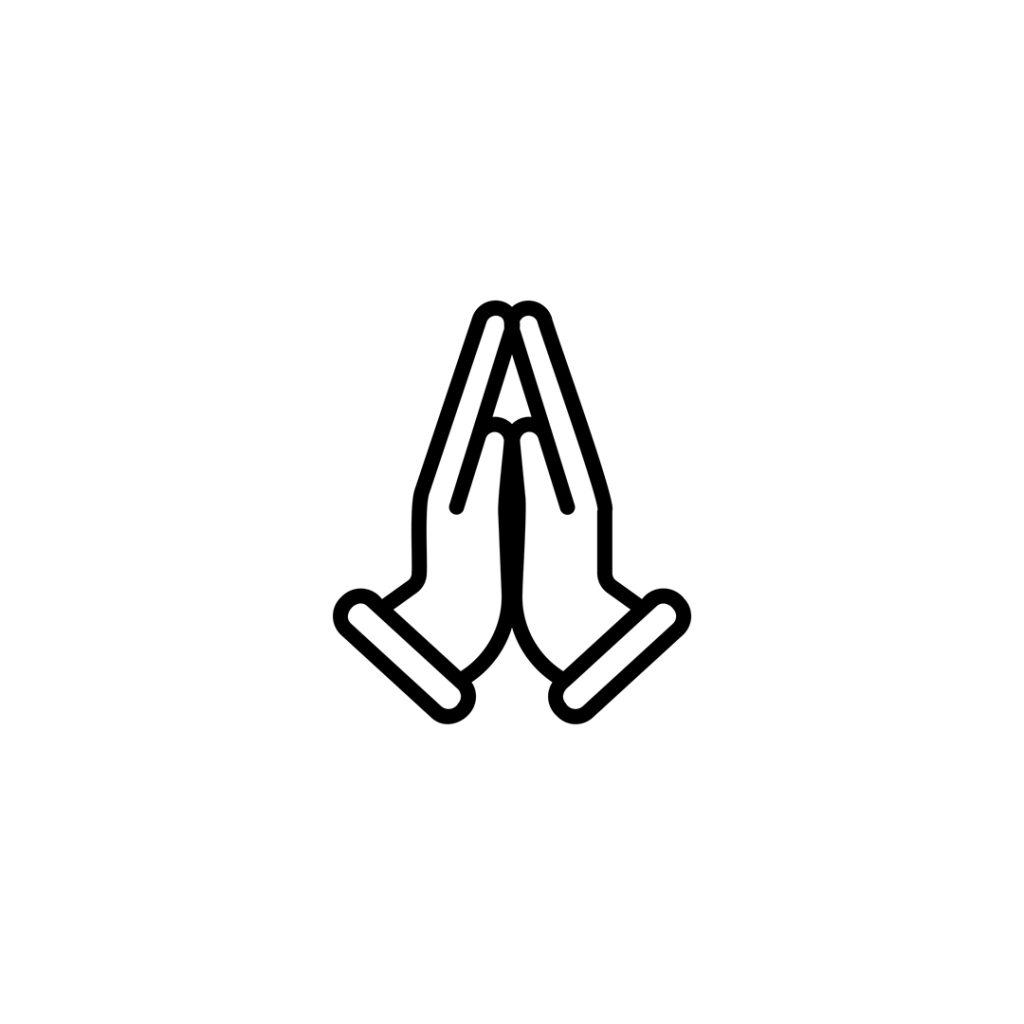Journaux, quotidiens, hebdomadaires, mensuels, télévision, radio, podcasts, réseaux sociaux, médias en ligne… Comment choisir ? À qui se fier ? Si la liberté de la presse est l’un des piliers de notre démocratie, le flot constant d’informations à notre disposition peut dérouter. Quelques pistes peuvent nous aider à nous y retrouver.
Le chiffre a quelque chose de vertigineux. Selon le dernier baromètre Kantar Public publié chaque année par le quotidien La Croix, plus de la moitié des Français et des Françaises ne font pas confiance aux médias. Ainsi, 57% ont déclaré se méfier de ce que disent les médias sur les grands sujets d’actualité. Alors que 75 % des personnes interrogées affirment “suivre l’actualité avec grand intérêt” -soit 15 points de pourcentage de plus qu’en 2022- 59 % d’entre elles dénoncent des médias “soumis aux pressions des partis politiques et du pouvoir”. Pire encore pour les journalistes, 56 % pensent que la profession ne résiste pas aux pressions de l’argent. Dur constat.
Si les médias n’ont pas pas bonne presse (!), en sont-ils responsables ? Faut-il tous les mettre dans le même panier ? Autrement dit comment rester informés de façon la plus juste et fiable possible ? A cet égard, pour les citoyens que nous sommes, le défi est grand. En effet, l’information est devenue un robinet gigantesque qui déverse en continu des informations de toutes sortes, souvent sans aucun tri ni hiérarchisation. Les chaînes d’information en continu, qui pourtant ne rassemblent pas des audiences importantes, font du buzz”, non par le sérieux des informations qu’elles produisent, mais par les polémiques qu’elles se plaisent à susciter. Il est en effet tellement moins coûteux d’inviter des spécialistes auto-proclamés que de produire des documentaires argumentés.
Le tri des… déchets
C’est pourquoi le meilleur et premier réflexe reste, me semble-t-il, la nécessité de bien choisir ses sources et de jeter le reste à la poubelle. Ou plus exactement de couper le son de ces chaînes de télé, ces émissions de radio, cette presse etc dont le maître mot est de créer de la dissension -et non du débat-, faire monter la sauce, lancer des petites phrases. Et de rester fidèle à des médias soucieux de la déontologie que l’on enseigne encore dans les écoles de journalisme. Quelle est-elle ?
Si on devait en retenir deux piliers, citons la vérification des informations et la diversification des sources. C’est là le baba du métier. Être sûr que les chiffres que l’on avance sont vrais, que la citation d’un tel ou d’un tel est bien celle-là et toujours amener la contradiction. Un journaliste n’est pas là pour imposer ses vues mais bien mettre en balance des opinions contradictoires. Au lecteur, à l’auditrice d’aller plus loin, de juger, de décider. Bien sûr, l’histoire nous le rappelle, la presse ici comme ailleurs est une presse d’opinion. Chacun a autour de soi des lecteurs assidus du Figaro, des fans de Libération, des abonnés depuis toujours au Monde, à L’Express ou au Nouvel Obs, qui ne pourraient imaginer lire autre chose tant ils se retrouvent dans ces écrits qui valident leurs façons de penser. De même qu’il existe des auditeurs des JT de TF1 plutôt que de France 2 et vice-versa. Pourquoi pas ? Tous ces médias historiques, sérieux sont des sources d’informations où travaillent des journalistes professionnels, qui ont mis en place des outils de contrôle des sources. Mais aucun ne peut se revendiquer neutre à 100%, puisque la neutralité n’existe pas. Ne serait-ce que par le choix des sujets traités et des autres abandonnés, la décision de faire appel à tel ou telle éditorialiste, de donner la parole à certains politiques et pas à d’autres.
S’enrichir de la variété
C’est pourquoi le second réflexe me semble être la diversité, le changement d’habitudes, le pas de côté… Changer provisoirement de chaîne de radio ou de télé, acheter un hebdo par curiosité, aller voir sur Internet ce qu’écrit tel ou tel média, permet d’enrichir son point de vue. A cet égard, la lecture de Courrier international m’enchante, de même que l’écoute de RFI, Radio France international. Se décentrer de l’actualité nationale, connaître les sujets qui embrasent la RDC ou le Pérou, découvrir le regard que porte la presse étrangère sur notre pays est passionnant. Bien sûr, me direz-vous, cela a un coût, en argent et en temps. Il est clair que bien s’informer exige un véritable travail, chronophage. Pourtant l’accès à la diversité peut être facilité par la multiplication des médiathèques qui proposent un bel éventail éditorial. Sans compter qu’il est toujours possible d’échanger entre amis ou voisins tel ou tel article, et pourquoi pas de créer des clubs de lecture ?
Oui, échapper à la prolifération des informations non vérifiées, trafiquées -les fameuses fake news-, avec à la manœuvre des individus ou des groupes de plus en plus agressifs, n’a rien d’une sinécure. Mais l’enjeu est essentiel, en termes démocratiques.
C’est pourquoi l’éducation aux médias relève d’une urgence grandissante. Des initiatives existent en ce sens, que ce soit via la Semaine de la presse à l’école et tout le travail proposé par le Clemi, le Centre pour l’éducation aux médias et à l’information, aux enseignants. Discuter avec les jeunes générations est tout aussi essentiel tant les adolescents ont tendance à “s’informer” sur les réseaux sociaux -et notamment Tik Tok- qui bien souvent véhiculent des thèses qui tiennent du complotisme. Heureusement, de nouveaux médias comme Hugo décrypte -du prénom de ce Youtubeur de 27 ans- font un vrai travail citoyen auprès des jeunes.«La vidéo devient une source encore plus importante d’information en ligne, en particulier chez les jeunes», souligne ainsi un rapport de l’institut Reuters pour l’étude du journalisme, rattaché à l’université anglaise d’Oxford.
Ainsi ce n’est pas tant le support -le papier hier, la vidéo aujourd’hui-, qui importe mais un contenu vérifié et identifié. Qui me parle et d’où doit être une question que l’on se pose…
Vidéos, podcasts, documentaires regardés en replay -comme “Le dessous des cartes”, ces formats courts d’Arte qui font le point sur un sujet d’actualité-, revues qui résistent telles Études, il est tant et tant de moyens de rester informé. En s’appuyant sur ce discernement nécessaire pour ne pas se noyer dans un trop plein qui n’a plus aucun sens, sauf celui de nous conduire à une impasse, celle de “l’aquabonisme”.
Nathalie Leenhardt, journaliste, ancienne directrice du journal Réforme